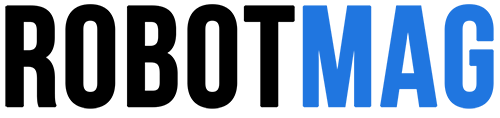Robots humanoïdes en Europe : promesses vs réalités industrielles

L’Europe face au défi des robots humanoïdes
Cet article est publié à l’occasion du Humanoid Robot Summit, qui se tient à Londres en mai 2025. Cet événement réunit les leaders mondiaux de la robotique pour discuter de l’avenir des humanoïdes, de leurs usages, de leur intégration dans nos sociétés et de leurs impacts économiques.
L’Europe est à la croisée des chemins. Tandis que la robotique humanoïde connaît une accélération spectaculaire à l’échelle mondiale, portée par des géants comme Tesla, Xiaomi ou Figure AI, le Vieux Continent cherche à imposer sa propre vision : celle d’une robotique plus éthique, plus utile et plus humaine.
Depuis les années 2000, des entreprises comme PAL Robotics en Espagne, Aldebaran (aujourd’hui United Robotics Group) en France, ou Engineered Arts au Royaume-Uni, ont posé les bases d’une robotique humanoïde à vocation sociale, éducative ou industrielle. Contrairement à d’autres régions qui misent sur la vitesse ou la massification, l’Europe privilégie une approche qualitative, mêlant excellence technologique, exigence réglementaire et acceptabilité sociétale.
Mais cette approche, aussi vertueuse soit-elle, peut-elle résister à la pression mondiale ? Alors que les estimations prévoient un marché de plus de 38 milliards de dollars à l’horizon 2035 (source : Goldman Sachs), et que des millions de robots humanoïdes pourraient entrer dans nos foyers d’ici 2060 (Bank of America), l’Europe doit faire des choix structurants pour ne pas se laisser distancer.
Entre potentiel industriel, demande sociale croissante (notamment liée au vieillissement de la population) et forces académiques reconnues, le continent européen dispose d’atouts réels pour s’imposer dans cette nouvelle ère technologique. Encore faut-il les mobiliser rapidement et stratégiquement.
Cet article propose une exploration complète du marché des robots humanoïdes en Europe : chiffres, acteurs, perspectives, défis et opportunités. Un état des lieux pour comprendre où en est l’Europe… et où elle peut aller.
Le marché mondial des humanoïdes : des chiffres vertigineux
Les grandes institutions financières ne s’y trompent pas. Selon Goldman Sachs, le marché mondial des robots humanoïdes pourrait atteindre 38 milliards de dollars d’ici 2035, avec une accélération attendue dès la fin de la décennie. Le coût de fabrication, historiquement élevé, a déjà été réduit de près de 40 %, ouvrant la voie à une adoption plus large dans l’industrie, les services, et à terme, les foyers.
De son côté, Bank of America va encore plus loin, anticipant 3 milliards de robots humanoïdes en service d’ici 2060. L’institution décrit trois phases d’adoption : une première phase industrielle (2025–2027), une expansion vers les services et l’éducation (2028–2034), puis une intégration massive dans la vie quotidienne (à partir de 2035).
Si la majorité de ces perspectives sont mondiales, elles posent une question essentielle pour l’Europe : quelle part pourra-t-elle capturer de ce marché colossal ?
Une dynamique européenne à part entière
L’Europe représente historiquement 20 à 25 % des investissements mondiaux en robotique. Cette proportion, bien que plus modeste face à l’Asie ou aux États-Unis, s’accompagne d’un ancrage fort dans la recherche fondamentale et l’éthique de la technologie.
À partir des projections mondiales, on estime que le marché européen des humanoïdes pourrait atteindre 9,5 milliards de dollars d’ici 2035, avec plus de 200 000 unités en service sur le continent. Ces robots seront principalement utilisés dans des contextes à forte valeur ajoutée : santé, logistique, éducation, assistance à la personne.
Ce marché se structure autour de pôles industriels (France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) et d’initiatives européennes (comme euROBIN, le réseau de recherche robotique soutenu par Horizon Europe).
Acteurs majeurs en Europe : diversité et spécialisation
Le paysage européen de la robotique humanoïde se distingue par la diversité de ses acteurs.
– PAL Robotics (Espagne) : REEM-C, TIAGo – Recherche, logistique, assistance
– Engineered Arts (Royaume-Uni) : Ameca – Robotique expressive
– Aldebaran / United Robotics Group (France/Allemagne) : NAO, Pepper, Romeo – Éducation, accueil, santé
– Enchanted Tools (France) : Miroki – Santé, hôtellerie, interaction sociale
– NEURA Robotics (Allemagne) : 4NE-1 – Industrie et logistique
Cette cartographie montre que l’Europe ne manque ni de talents ni d’initiatives. Elle mise sur des approches complémentaires : des robots expressifs pour le public, des plateformes ouvertes pour la recherche, des assistants dédiés à des tâches précises.
Analyse SWOT du marché européen
Forces :
– Fort écosystème de recherche et de formation
– Approche responsable, éthique et transparente
– Présence de leaders technologiques reconnus
– Financements publics européens
Faiblesses :
– Fragmentation réglementaire et linguistique
– Accès limité au capital-risque
– Temps de mise sur le marché plus long
– Coûts de production élevés
Opportunités :
– Vieillissement de la population
– Besoin d’automatisation dans la santé, l’éducation, la logistique
– Croissance du deeptech européen
– Régulation éthique comme atout concurrentiel
Menaces :
– Concurrence frontale des géants non-européens
– Rejet potentiel du grand public
– Dépendance aux composants critiques importés
– Contexte économique incertain
Vers une adoption responsable et stratégique
Le marché des robots humanoïdes en Europe est encore jeune, mais prometteur. Si les États-Unis misent sur la vitesse et les volumes, et la Chine sur la standardisation, l’Europe a un autre atout : une robotique plus humaine, plus éthique, et mieux intégrée à la société.
Pour y parvenir, il faudra renforcer les partenariats public-privé, investir dans la production locale de composants, harmoniser les cadres juridiques… et surtout, faire dialoguer ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs, et citoyens.
Le robot humanoïde ne sera pas seulement un outil. En Europe, il peut devenir un compagnon de soin, un collaborateur de confiance, ou un ambassadeur technologique. Mais il ne faut pas attendre que les autres tracent la voie.